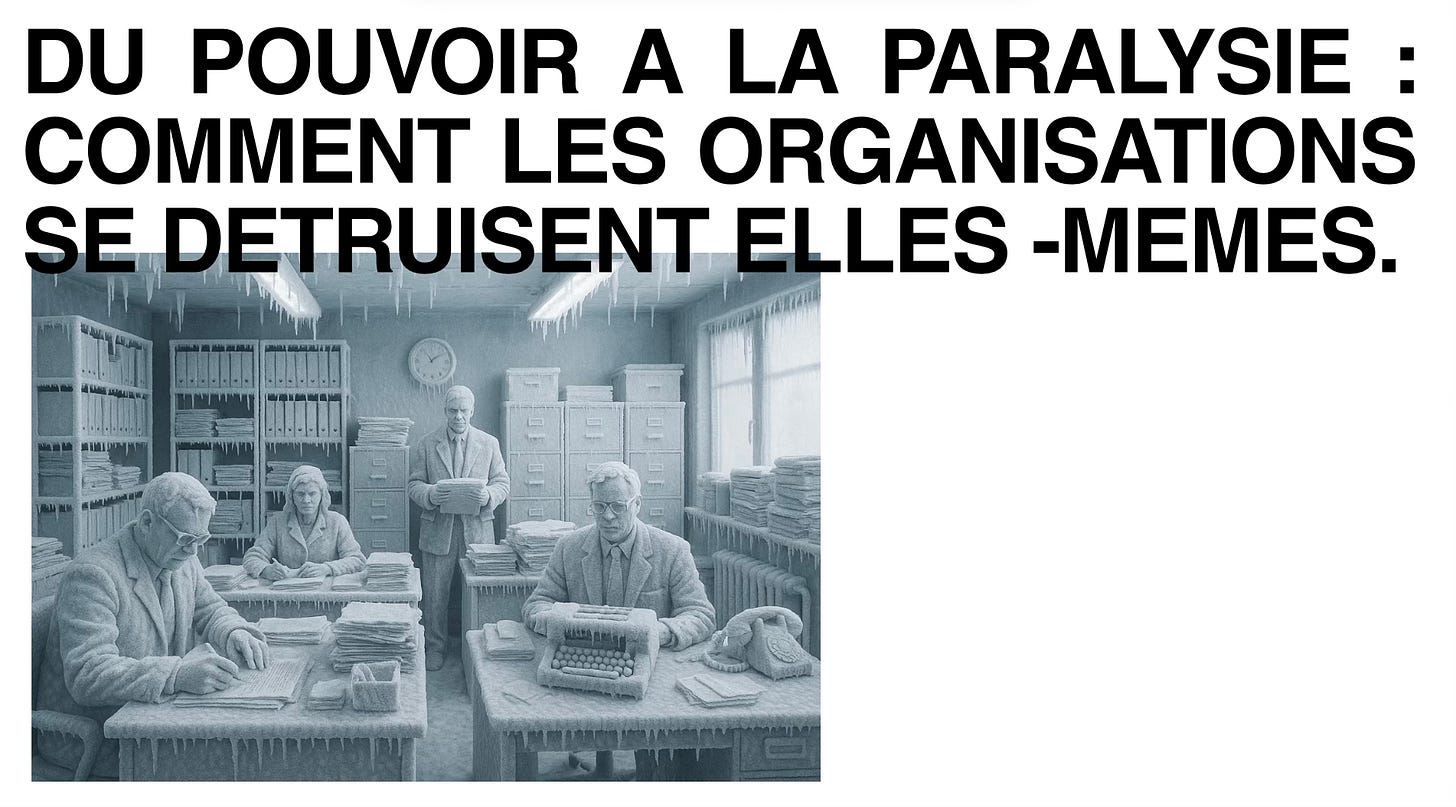POURQUOI LES LEADERS FINISSENT PAR ECHOUER ?
Par Xavier Ferras, Professeur de management de l’innovation et de la technologie à l’ESADE Business School. Docteur en économie et gestion des entreprises.
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à 1000X pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.