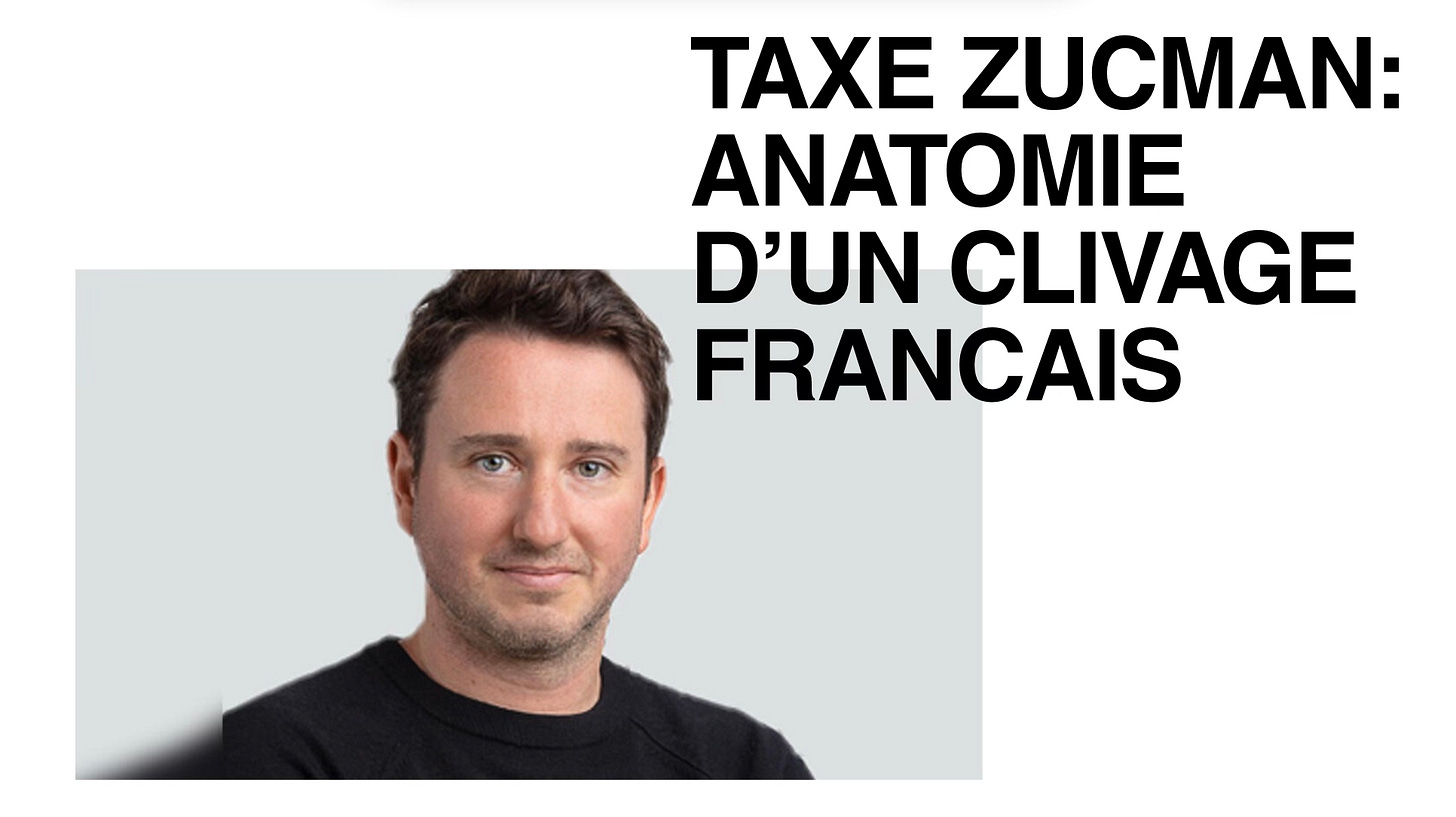TAXE ZUCMAN : ANATOMIE D'UN CLIVAGE FRANCAIS
Chaque décennie en France semble redécouvrir la même querelle : faut-il, et surtout peut-on, imposer davantage les plus grandes fortunes ?
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à 1000X pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.