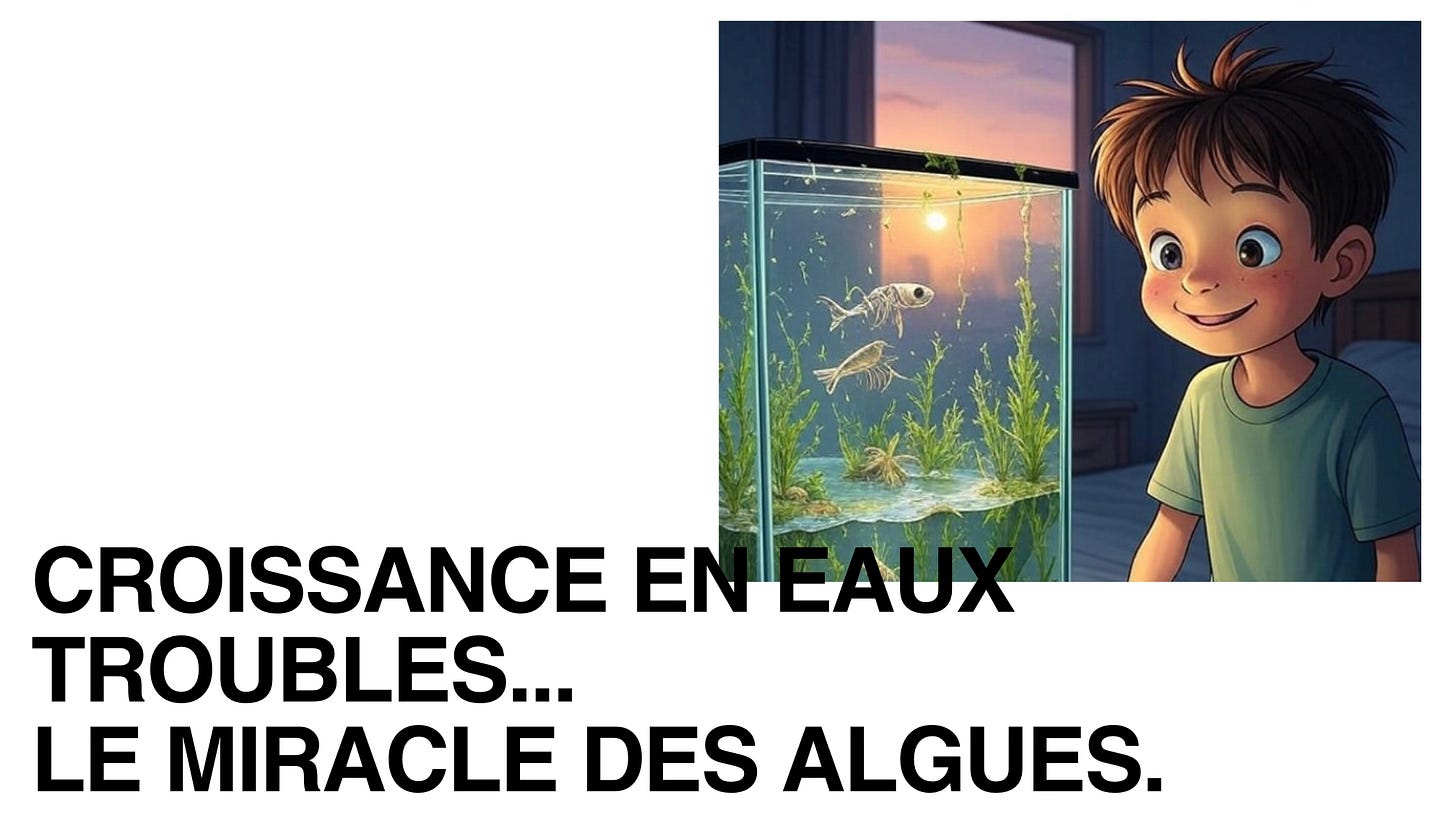"Depuis que je suis Président, la France a connu une croissance de 10 %…"
Chronique d’un chiffre qui se voulait triomphe et qui sonne comme un aveu.
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à 1000X pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.