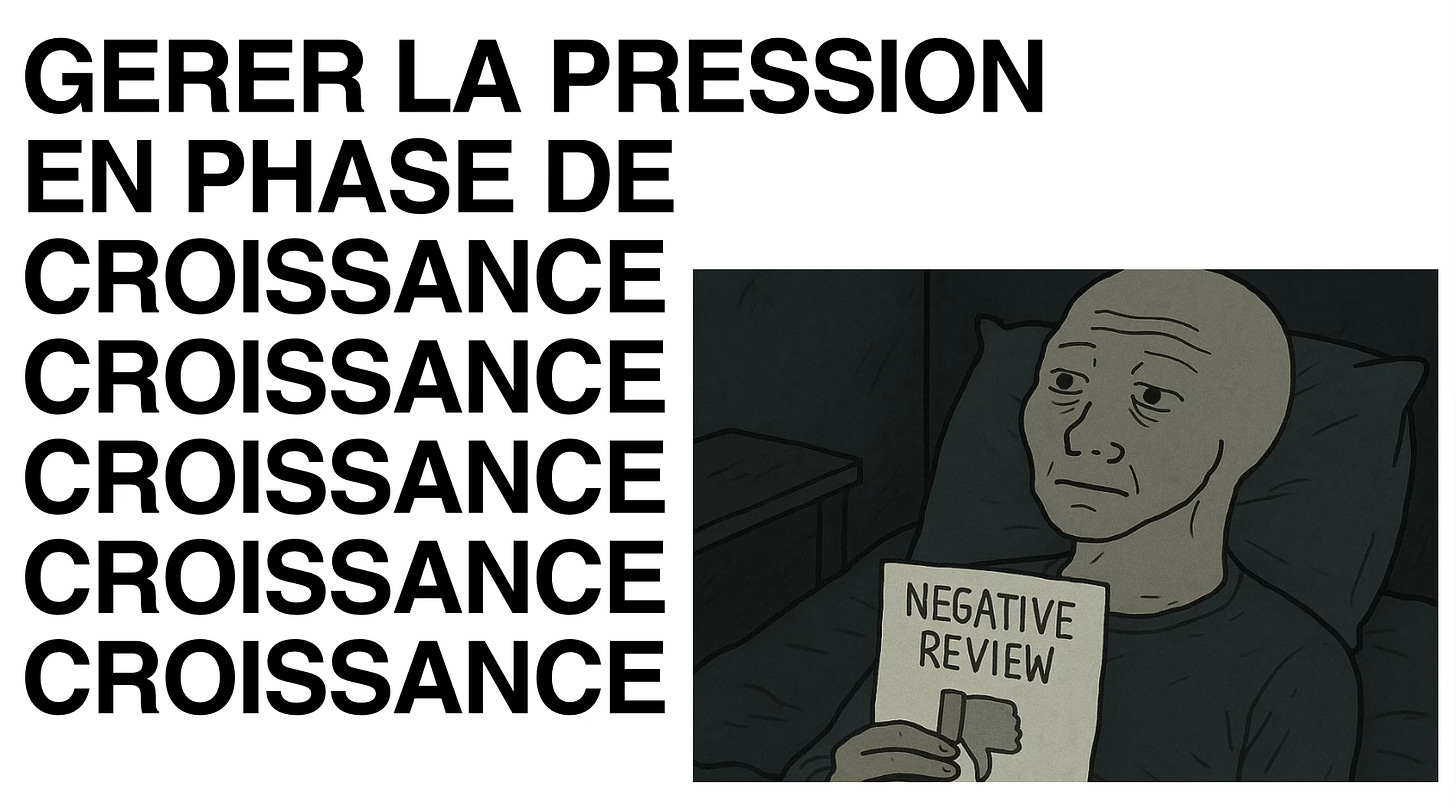BIEN-ETRE DE L'ENTREPRENEUR EN CROISSANCE : LA TENSION DES SOMMETS
À l’heure où la performance économique est de plus en plus scrutée, la santé psychique des dirigeants ne peut plus être reléguée au rang de variable d’ajustement.
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à 1000X pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.