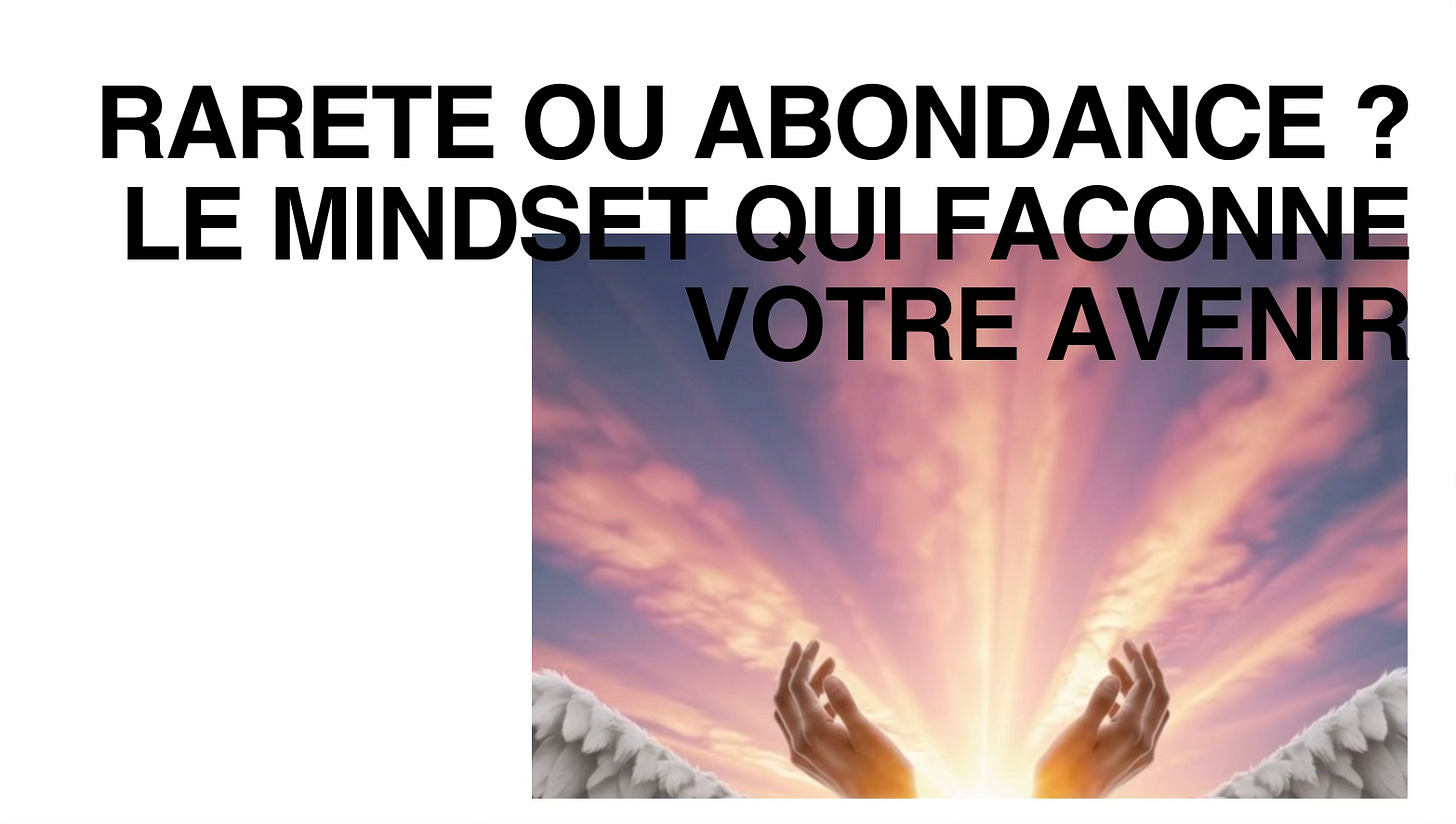ABONDANCE OU RARETE : LE CHOIX DE MINDSET QUI FAÇONNE VOTRE AVENIR
Deux visions dominantes, presque archétypales, traversent l’histoire économique et la psychologie de la décision : la logique de rareté et la logique d’abondance.
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à 1000X pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.